Mérite, tactique et cynisme

« On méritait de gagner ; ils ont triché ; on s’est fait voler. » Lancinante rengaine du perdant, ce chant du cygne déplumé résonne assez régulièrement dans les vestiaires larmoyants des stades de football français chaque année. « On était plus fort ; on a mieux joué ; ils ont refusé le combat loyal ; ils ont fermé le jeu » couronne en général l’argumentaire du vaillant perdant déconfit. C’est l’opposition entre l’esthète et le sobre, entre la courbe et la droite, entre le paon et le renard. C’est l’expression de l’incompréhension entre deux systèmes différents, habituellement nommés spectacle et efficacité. En football idéal, seule l’équipe qui proposerait ce que d’aucuns appellent le beau jeu remporterait les trophées les plus prestigieux. Nul n’oserait contester la suprématie artistique et esthétique du vainqueur, qui réunirait donc toutes les qualités du monde, et tutoierait la perfection.
Herrera, Rocco et leurs successeurs ont complexifié à jamais le monde du football, et réfuté par les faits l’idéal mort-né du football spectacle, au sens commercial du terme. Ils ont démontré que gagner n’était pas qu’une affaire d’apparat, ni d’entrechats, mais avant tout d’organisation, d’intelligence, et de maîtrise collective. Ils ont transformé un jeu en sport, des éructations en réflexions.
Reste que le mérite est toujours au centre des débats d’après-match, sans qu’en soit jamais rappelée la valeur subjective. Le mérite joue sur le terrain de la morale, de la dignité, des valeurs. Valeurs qui seraient universelles, uniformes, et incarnées par un style de jeu donné, sans que quiconque puisse en expliquer la raison ou l’origine. Délicieuse arnaque que cette auto-appropriation de l’éthique et de la légitimité, sans fondement rationnel ni crédible. Le recours à l’argument suranné du mérite sert trop souvent à masquer amertume et frustration, à éviter l’aveu de faiblesse, dans un ultime élan d’orgueil qui ne trompe personne. Le mérite serait l’application d’un football débridé, où l’effort physique serait roi, et la prouesse technique couronne. Le mérite serait étroitement lié à une volonté de ce qu’on appelle bien souvent « faire le jeu », à une prise de risques affichée, à une domination territoriale, à la possession du ballon. A la question pertinente « dans quel marbre est-ce gravé », personne n’a jamais pu répondre.
Les maîtres tacticiens italiens des années 90 n’ont cessé d’entendre l’argument du mérite dans la bouche des adversaires vaincus. Les Trapattoni, Capello, Lippi, façonnèrent des collectifs performants, efficaces, mais trop souvent victorieux pour que l’intelligentsia leur accordât en plus le mérite. Il était inacceptable de sortir à ce point des sentiers battus, et de pousser l’insolence jusqu’à défaire une à une des équipes toutes plus méritantes les unes que les autres.
Ce qu’oublient trop souvent les défenseurs de cette déontologie de circonstance, c’est que le football est un sport qui fait la part belle à une composante passionnante : la tactique. Qui dit tactique dit stratégie, plan et organisation rationnelle pour parvenir à un résultat. En football, cela consisterait par exemple à maîtriser les zones de vérité au bon moment, à définir des temps de jeu, à associer des joueurs complémentaires seyant à un système et à des consignes propres à ce système. De tels paramètres ne sont intégrés que de façon très incomplète la plupart du temps, car une tactique trop parfaite aurait, dit-on, pour néfaste conséquence de brider certains talents. L’aspect tactique le plus souvent négligé, car jugé destructeur de spectacle, est incontestablement la défense. Tradition italienne depuis des décennies, la défense est le gros problème du football commercial de ces dernières années, pour plusieurs raisons : elle est difficile à construire, un obstacle aux scores fleuves, et une entorse au règlement du football méritant. Construire une équipe autour de sa défense, et privilégier – sacrilège – la défense à l’attaque, comme la Grèce en 2004, est tactiquement payant si les joueurs correspondent au projet, mais provoque invariablement railleries, huées, et recours à l’argument du mérite. C’est le PSG-Milan de 95, le Nantes-Juve de 1996, ou le Marseille-Parme de 99. Au chaleureux entrain français, les Italiens ont opposé leur culture du résultat, jugée froide et sans saveur. Par qui ? Par les perdants, pardieu. Ce football pensé fait peur. Pire, il est même renié par ceux qui l’empruntent à l’occasion. Dix ans après une victoire très italienne de la France en Coupe du Monde, les spécialistes français du ballon rond préfèrent toujours la France de 82, et ne reconnaissent que du bout des lèvres les mérites de l’équipe de Jacquet.
Au soir du match nul de la Squadra Azzurra contre les Etats-Unis en 2006, le capitaine italien Cannavaro déclara qu’il était temps de revenir aux grands principes historiques du calcio : défense, tactique, et cynisme. Il fut écouté, avec le succès que l’on sait, mais cette anecdote illustre bien une certaine conception du football, qui voudrait que le jeu ne soit plus une fin en soi, mais un moyen calibré, géré, pour atteindre le seul et unique but valable : la victoire. Les grands principes du football de plage sont ainsi renversés : le maître tacticien a bien compris qu’il fallait viser l’utile, le fonctionnel, et ne prendre le ballon des pieds de l’adversaire que pour en faire quelque chose. Le premier grand objectif est de préserver son propre but, puis de surprendre – une fois suffit – l’adversaire au moment opportun. L’action d’éclat n’apparaît que pour servir une cause, et non plus pour épater la galerie. Le mérite revient au vainqueur, et seulement au vainqueur, qui a su grâce à ses talents, mais également à son intelligence tactique, maîtriser les débats. Les gémissements de l’opposition dépucelée n’ont aucun effet sur le tableau d’affichage, et ça, les Italiens l’ont compris avant tout le monde. Peut-être faut-il y voir une résurgence du célèbre esprit de conquête romain de l’Antiquité.
La sélection du peuple

A moins d’un an de la Coupe du Monde, il convient de s’interroger sur les raisons qui poussent les peuples à se passionner pour les compétitions internationales, plus que pour les compétitions de clubs. En effet, il suffit de sonder les gens pour se rendre compte que, passé vingt ans, seuls les mordus de football persistent à suivre l’intégralité des matchs, toutes compétitions confondues. Le travailleur quadragénaire, qui, dans l’absolu, n’aime pas moins le football que son fils de douze ans, n’a cure des Nancy-Boulogne, des Siena-Catania, ou encore des Bolton-QPR. Il pourra, si son emploi du temps le lui permet, se laisser bercer par une soirée de Ligue des Champions de temps en temps, mais l’intérêt suprême ne germe qu’une fois tous les deux ans, au mois de juin, lorsqu’un pays entier s’arrête de tourner pendant une heure et demie tous les trois jours, adoptant ainsi le rythme de son équipe nationale. Même les Anglais, pourtant religieusement attachés à leurs clubs de cœur, reconnaissent vibrer avec une intensité supérieure lorsque le God Save The Queen précède un match du onze de la rose. La réussite nouvelle de leurs clubs désanglicisés en Ligue des Champions n’est finalement qu’un refuge, permettant, tel le lot de bières du samedi soir, d’oublier les déboires récurrents de leur sélection. Quelles sont les raisons de ce surplus de passion pour les équipes nationales ?
L’un des premiers arguments communément avancés est la rareté des grandes compétitions. Il faut reconnaître que, la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe n’ayant lieu que tous les quatre ans, le spectateur n’a guère l’occasion de se lasser ou d’avoir des états d’âme. Cette rareté tranche singulièrement avec la monotonie des matchs du weekend, sorte de routine de plus en plus fade, à part peut-être en Angleterre. D’aucuns diront que la période estivale est plus propice également aux pics d’audience et à l’excitation des sens, même si les mois de juin et juillet sont aussi, par exemple, ceux des examens. Le barbecue familial sur la terrasse un soir de finale laisse toutefois augurer de joyeuses perspectives, et fait partie des grandes habitudes folkloriques du supporter de football moyen.
La notion de communion nationale est fréquemment dépeinte comme l’un des atouts les plus saillants d’une grande compétition. L’idée que toute une ville, tout un pays, tout un peuple, partage les mêmes attentes, les mêmes émotions, les mêmes espérances, l’espace de quelques semaines, confère à cette vitrine du football un aspect unique, que peu d’autres événements peuvent reproduire. C’est le sentiment de pouvoir dialoguer avec toute la rue sur le chemin de la boulangerie, en sachant que le boulanger lui-même portera le maillot adéquat, et vous proposera gracieusement son équipe type en vous donnant votre baguette. La possibilité de croiser un amas de personnes agglutinées devant un écran dans une université, une Fnac ou un supermarché, captivées par le même événement que vous, demeure assez insolite et particulière. C’est à la fois l’expression d’une agitation hors norme, et la pause salvatrice d’une société en manque. C’est la résurgence d’un désir de partage, enfoui dans les abysses du quotidien ; et c’est surtout l’expression – certes temporaire – d’une joie de vivre et d’une allégresse ressenties par tous au même moment.
Le concept de sélection reste au centre de l’attachement des peuples à leurs équipes nationales. Une sélection, c’est par définition la réunion sous le même maillot des meilleurs joueurs d’un même pays. C’est le principe d’excellence, le label rouge du football, qui fait renaître chez chaque individu le sentiment d’appartenir à une même entité, d’être représenté dans son équipe nationale, pour faire valoir les caractéristiques inhérentes à sa propre société. On parlera facilement, et non sans raisons, d’une Allemagne valeureuse, d’une Italie calculatrice, d’un Brésil flamboyant, etc. Chaque équipe nationale incarne les valeurs d’un pays et de ses habitants, qu’elle représente avec fierté. Il y a bien une volonté d’être le meilleur, de surpasser l’adversaire, mais dans un esprit pacifique. Le match Iran-USA de 1998 fut, de ce point de vue, un symbole fort. Les « ennemis » Marseillais et Parisiens, Barcelonais et Madrilènes, Intéristes – ah non, pardon – et Turinois, se retrouvent ensemble avec le même maillot sur les épaules pour allier compétences et talents et faire aboutir un projet. Le concept est basique mais fort.
Le prestige d’une Coupe du Monde est inégalé, inégalable, et vraisemblablement unique en son genre, tous sports confondus. Les exploits d’un Pelé ou d’un Maradona sont dans les mémoires ad vitam aeternam, et le trophée en or massif reste le graal de tout joueur de football professionnel. Les joueurs s’y préparent avec soin, quitte à lever le pied en club, afin d’être prêts le jour J, car l’opportunité ne se présente qu’une fois tous les quatre ans. Pour les joueurs comme pour les supporters, c’est l’occasion à saisir, l’événement majeur, la chance de se hisser au sommet du football mondial, et de passer à la postérité.
Les équipes nationales sont, de surcroît, dénuées des maux qui gangrènent le football d’aujourd’hui : pas de transferts coûteux, pas de dettes, pas de salaires astronomiques. En sélection, ne comptent que le talent et le rendement. Il est toujours possible d’évoquer les primes ou les sponsors, mais tout ceci semble bien léger face aux frasques d’un Real, d’un Chelsea ou d’une Inter. Le joueur ne se rue pas vers le club le plus offrant, mais se borne à servir la cause d’un pays auquel il est fier d’appartenir, et qu’il veut faire briller sur la scène internationale. Le jeu pratiqué est intrinsèquement lié à la culture du pays concerné, et pas aux soubresauts de présidents milliardaires.
En bref, la sélection redonne des lettres de noblesse à un sport en chute libre, et reste la seule référence fiable dans le football actuel. Il n’est donc pas surprenant que les peuples l’aiment tant, et que les agents d’un football mondialisé ne soient pas encore parvenus à l’éliminer, malgré les espaces de plus en plus restreints qui lui sont alloués. Il y a fort à parier que les audiences records et l’argent qui en découle soient l’unique raison de la survie des équipes nationales. Comme quoi, même indirectement, le peuple a toujours le dernier mot.
De la spécialisation d'excellence à l'éclectisme médiocre

L’une des grandes caractéristiques d’un sport collectif est l’association réfléchie d’individualités aux attributs divers et variés au sein d’une même entité, avec pour leitmotiv la compétitivité. Les trois lignes qui composent une équipe de football ont des fonctions très différentes, et sont elles-mêmes subdivisées en différentes catégories, différents postes, nécessitant des qualités spécifiques, répondant à la fois aux exigences de la ligne concernée et à celles, plus singulières, du poste en question. Chaque membre d’un collectif joue un rôle donné, en fonction de ses qualités, de sa ligne, et des consignes de son entraîneur. Ce dernier façonne ainsi l’organigramme le mieux adaptés à sa philosophie de jeu, mais également et surtout le plus efficace sur le terrain. La stratégie, le sens tactique et la réactivité tiennent une place prépondérante dans le monde du football depuis de nombreuses années, et des entraîneurs comme Capello ont démontré que l’intelligence de jeu et la gestion tactique d’une équipe prévalaient sur le talent brut et l’individualité pure, et surpassaient de très loin les convictions plus « libérales » d’autres entraîneurs. Il était assez désopilant d’entendre le ton à la fois admiratif et surpris des commentateurs du match PSG-Milan de 95, s’extasiant devant la rigueur défensive d’un Panucci, focalisé sur le marquage de son joueur, concentré sur la préservation d’un périmètre de jeu défini sur tableau noir avant le match. C’était avant l’acquisition par les internationaux français en Italie des préceptes tactiques transalpins, et leur application lors de la Coupe du Monde 1998 par l’équipe de Jacquet.
En football, en théorie, les défenseurs défendent, les attaquants attaquent, et les milieux assurent la liaison. Du moins, c’est la conception originelle des choses, la plus logique, et a priori la plus pertinente. Chaque joueur est spécialisé dans un domaine précis, réservé, qu’il maîtrise mieux que son camarade, lui-même expert dans un autre domaine. Rien de bien surprenant d’ailleurs, car si l’on observe d’autres professions, on s’aperçoit par exemple que le proctologue sera rarement amené à opérer un patient des dents de sagesse, ou que le pizzaiolo du bout de la rue n’est que très peu rodé à la grande cuisine d’un cinq étoiles parisien. Mais le football est capricieux, et aime se distinguer, sous couvert d’une modernité dont la définition très relative demeure assez floue. Aujourd’hui, les défenseurs attaquent, les attaquants défendent, et les milieux font absolument tout. En dehors du côté baroque un peu surfait, finalement assez risible, la question est : un tel système offre-t-il un football plus performant, meilleur que par le passé ? En Italie, la réponse est clairement non. Les défenses, jadis réputées pour leur imperméabilité, sont de plus en plus friables ; les attaques impressionnent nettement moins qu’à l’époque de Batistuta, Ronaldo ou Van Basten ; quant aux milieux, ils ne brillent que par une activité physique diffuse et brassent beaucoup d’air. Le niveau intrinsèque du calcio est unanimement reconnu plus faible qu’il y a dix ans, et les performances des équipes italiennes en coupe d’Europe ne méritent guère qu’on s’y attarde.
Plus inquiétant, des types de joueur disparaissent, au profit d’autres, multitâches. Le libéro est mort avec l’arrivée de la défense en ligne, permettant de jouer le hors jeu, mais les défenses ont-elle pour autant gagné en efficacité ? L’extinction d’un tel poste, si utile à l’époque du véritable catenaccio, commence à dater, mais d’autres suivent la même voie. Le numéro 10 traditionnel, à la Zidane, se fait rare, car le football moderne serait condamné à passer par les côtés. Gourcuff semble faire exception en France, mais ils sont peu nombreux dans ce cas ; le récupérateur pur, type Gattuso, est banni des clubs de football, de même que le buteur exclusif à la Inzaghi. Jugés peu techniques, pas assez spectaculaires – comme nous l’avons vu précédemment, la notion de spectacle est relative –, de tels joueurs n’auraient plus leur place dans un football qu’on nous affirme plus exigeant, plus éprouvant, réservé à une élite aux attributs bien définis. Il y a dix ans on alignait Rui Costa derrière Batistuta, Boban derrière Bierhoff, et les milieux de terrain étaient composés, entre autres, de joueurs comme Deschamps, Wise, Davids, récupérateurs purs, dont la préoccupation première était d’arracher le ballon des pieds de l’adversaire. Aujourd’hui, trois Pato pourraient constituer un trio d’attaque, et Gerrard et Ballack sont les milieux « couteau suisse » tendance. Un joueur comme Pirlo est repositionné avant même d’être essayé à son poste de formation ; on lui assigne des tâches défensives auxquelles il est inapte, pour lui inculquer au fer rouge des qualités qu’on lui souhaiterait. On reclasse, on dénature, on formate. Un défenseur doit être grand et lourd. Où sont les héritiers des Laurent Blanc, des Maldini, des Sammer ?
Comme souvent, le système passe difficilement l’épreuve des faits. En effet, on s’aperçoit qu’à 36 ans un Inzaghi reste, lorsqu’il est physiquement valide, extrêmement utile à son équipe. Sa rareté le rend précieux, et permet de mesurer le décalage entre l’efficacité d’un secteur offensif comprenant un vrai buteur, et l’irrégularité – doux euphémisme – d’une attaque standard 2009. A 41 ans, Paolo Maldini fut l’un des tout meilleurs défenseurs d’Italie la saison dernière, et ridiculisa bien des attaquants de vingt ans de moins. L’équipe de France de Benzema et Anelka se priverait-elle des services d’un Papin, ballon d’or 91 et maître artificier en première division avec l’OM ? Le vrai problème est qu’à force de former des latéraux offensifs, ces derniers ne savent plus défendre, à l’exemple des attaquants travailleurs qui ne savent plus faire une reprise de volée convenable. Des gestes, des styles, des métiers, des talents se perdent, sans que les substituts parviennent à convaincre les observateurs avertis. A force de trop en demander aux joueurs, on n’obtient que tiédeur et dilettantisme. D’un football de spécialistes nous sommes passés à un football d’éclectisme médiocre, où tout se fait dans une moyenne, sans quête de l’excellence.
Ces mal-nés

Depuis quelques années, il ne fait pas bon être jeune, italien, et footballeur. Du très idéologique présupposé « jeune Italien = mauvais » on voudrait presque faire un axiome, une loi naturelle élémentaire, qui sonnerait comme évidente à toute oreille bien-pensante. Peu importe que les sélections nationales de jeunes fassent partie des meilleures depuis des décennies, peu importe que les rares expériences de la Juve, l’Inter et la Roma avec les Santon, Motta, Marchisio, Giovinco, soient concluantes en 2009, « les jeunes Italiens n’ont pas le niveau. Ils l’avaient au siècle dernier, mais depuis, tout a disparu ; en quelques années la jeunesse italienne est passée d’excellente à indigne. Il va de soi que les quelques individus osant douter de ce grand principe ou de son bien-fondé ne peuvent être que des extrémistes nationalistes et réactionnaires ». Et pourtant, sans nous reconnaître de près ni de loin dans aucun de ces trois termes, il nous apparaît clairement que l’idéologie en question est à la fois irrationnelle, irréaliste, et irresponsable.
Irrationnelle, parce que totalement farfelue dans l’absolu. L’idée que la jeunesse italienne soit tombée en déliquescence à l’orée du vingt-et-unième siècle, quelques années seulement après l’arrêt Bosman, n’a de raison d’être que pour les agents d’un projet politique en vogue depuis quelques années : la négation et la destruction de ce que nous appellerons le terroir. Le terroir a du charme, de la saveur, et peut même parfois venir chatouiller les narines sensibles de nos grands penseurs modernes, avides d’uniformité et de propreté universelle. C’est un peu l’opposition entre un munster au lait cru et la tranche de fromage en plastique que chaque « citoyen du monde » (expression très à la mode) a l’immense plaisir de retrouver dans son cheeseburger. La jeunesse italienne se serait donc éteinte peu après la décision d’ouvrir les frontières du football. Un malheureux hasard qui aurait conduit les dirigeants, tristes et mélancoliques, des clubs européens les plus riches, à se tourner, presque la larme à l’œil, contraints et forcés, quasi-exclusivement vers l’étranger pour construire leur équipe. Bollocks, comme disent les Anglais.
Irréaliste parce que relevant plus d’effets spéciaux dernier cri que de ce que peut constater chaque semaine tout observateur averti du football italien, de son championnat comme de ses sélections. Personne ne peut sérieusement croire que l’arrêt Bosman aurait subitement vampirisé les nouvelles générations, et brisé un processus bien établi en Italie depuis des décennies. La concordance des dates est d’ailleurs l’un des meilleurs éléments de dénonciation de la supercherie. Que tout se soit parfaitement imbriqué sur une période aussi courte, à mesure que la mondialisation s’érigeait en concept suprême et implacable dans nos sociétés aux jambes écartées, croupes tendues, ne serait que coïncidence fortuite ? A d’autres.
La seule réalité palpable est le sabotage organisé de l’ascenseur social italien, que nous évoquions il y a quelques semaines. Les jeunes talents sont toujours formés, et ne se gênent pas pour mettre à mal les défenses multiculturelles de nos gros clubs déficitaires, ou pour ridiculiser régulièrement les grands attaquants-publicitaires. Or, ces talents locaux n’ont plus accès à l’élite de leur pays, ce qui nous amène au troisième point ...
Irresponsable, parce qu’elle brise des carrières, des espoirs, un pays. Un club de football fortuné, qui prospère depuis un siècle sur un patrimoine et un territoire précis, bénéficie d’installations, d’avantages propres à un environnement donné, à un cadre géographique donné, peut-il raisonnablement tourner le dos à son pays et à ses forces vives ? N’existe-t-il pas, de facto, un devoir de responsabilité vis-à-vis de ces deux entités liées ? L’appartenance culturelle est-elle à nier ou à bannir ? Sommes-nous tenus d’être les bons élèves de la mondialisation, et de fuir tout ce qui serait susceptible d’évoquer un attachement quelconque au territoire dont nous sommes issus ? Est-il indispensable d’aller chercher loin ce qu’on peu trouver à proximité, de nier l’enracinement, et de construire des collectifs qui n’en sont pas ? En excluant les locaux, les clubs en question s’excluent d’une certaine façon de leur pays d’origine, dont les traits saillants sont ainsi éliminés, à plusieurs niveaux : celui des joueurs, condamnés à l’exil ou au changement d’orientation, faute de perspectives réelles chez eux, et celui des cultures propres, sortes de dernières forteresses résistant à l’Empire, encombrantes pour qui voudrait se fondre dans un moule à uniformité.
Ils s’appellent Massimo, Andrea, Alessandro, mais il eût mieux valu qu’ils fussent nommés Rodrigo, Gilberto ou Luizao. Ainsi sont-ils mal nés, au mauvais endroit au mauvais moment. Jeunes prometteurs il y a cinq ans, ils ont longtemps attendu des offres jamais émises, et, las de stagner dans les bas-fonds du championnat italien, ils ont choisi l’exil. Il y a une dizaine d’années ces joueurs pouvaient encore espérer évoluer au Milan AC, à l’Inter ou à la Roma, mais aujourd’hui les voies sont obstruées, et le système verrouillé. Ils connaissent donc des fortunes diverses en Ecosse, en Allemagne ou en Russie, loin d’un environnement familier qu’ils étaient à l’origine censés intégrer et constituer. « Que l’exil leur soit rarement profitable n’a aucune importance ; qu’il participe de la destruction de l’italianité des club et de la baisse conséquente du niveau général, encore moins ». Le système ne s’embarrasse pas de considérations de ce genre, et préfère la mosaïque à la logique, l’art moderne à l’art tout court. Finalement, la seule question qui subsiste est la suivante : quel est le prochain sur la liste ?
Filippo Inzaghi, l'homme but

Un soir de mai 2005, à Istanbul, un attaquant de 32 ans assista de la tribune à la déroute mémorable de son équipe en finale de la Ligue des Champions. Deux ans plus tard, ce même attaquant, cette fois sur le terrain, inscrivit les deux buts de la victoire de son équipe, au même stade de la compétition et face au même adversaire. Déprimé et déclaré fini l’été 2005, transfiguré l’été 2007, tel est Superpippo Inzaghi, homme de paradoxes, réputé pour sa capacité à surprendre, à détoner.
Inzaghi est d’abord un joueur atypique, au profil extrêmement rare, presque anticonformiste. A l’heure où l’idéologie dominante et bien-pensante stipule que tout attaquant doit avoir un physique d’athlète avant tout, parcourir le terrain dans tous les sens, défendre, et remonter les ballons, Superpippo faufile sa silhouette filiforme entre les mailles très lâches des filets défensifs d’1,90m du monde entier. A la puissance et à la lourdeur de ses adversaires il oppose vivacité, anticipation, opportunisme, lucidité, efficacité, et surtout intelligence. Inzaghi ne se disperse pas, ne tergiverse pas, ne se répand pas en fioritures, mais vise l’essentiel, le concret, le but. Limité techniquement, limité physiquement, il a su développer d’autres atouts plus abstraits, moins accessibles au commun des footballeurs. Pippo joue d’abord avec sa tête, et s’efforce d’avoir en permanence plusieurs temps d’avance sur ses adversaires, qui ne le voient la plupart du temps pas s’échapper, et se ruer vers le but tel un oiseau de proie déchaîné.
Superpippo est toujours à la limite, sur le fil, et jongle avec les interstices du système. La célèbre citation de Sir Alex Ferguson, « il est né hors jeu », ne doit pas faire oublier que cet art d’être en permanence entre deux mondes est précisément l’un de ses grands points forts. L’avant-centre du Milan AC a un don pour se faire oublier, frapper où il est le moins attendu, et sortir grand vainqueur de parties d’échecs qu’il maîtrise avec toujours plus de brio chaque saison.
En effet, le temps semble ne pas avoir d’emprise sur Inzaghi. Les blessures sont plus fréquentes qu’il y a cinq ans, les temps de récupération sont un peu plus long, mais l’instinct du buteur et l’efficacité sont toujours intacts. Lors de la saison 2007/2008, les blessures n’ont pas permis à Ancelotti de le titulariser régulièrement, mais lorsqu’il est revenu au printemps, l’habituel buteur de Ligue des Champions a fait parler la poudre en championnat, et de quelle manière ! Entre le 5 avril et le 18 mai, dernière journée, Inzaghi a inscrit 10 buts en 7 matchs, 588mn, soit plus d’un but par heure ! Un bilan digne du Batistuta de la grande époque (pour mémoire, Batigol présentait des statistiques du même type au début de la saison 98/99) ! La saison dernière, assez curieusement, Ancelotti a tâtonné six mois avant de titulariser durablement le meilleur buteur de l’équipe. Rarement blessé, Pippo n’a été titularisé qu’à 3 reprises en championnat avant la trêve, pour la simple raison que son entraîneur lui préférait Pato, Borriello et Shevchenko, dans un schéma tactique à un seul attaquant de pointe. Le 8 mars 2009, avec un hat trick contre la Sampdoria, Inzaghi se rappela immédiatement au bon souvenir de Carlo et de ses concurrents. Il renouvela l’exploit du printemps précédent, en inscrivant, entre le 8 mars et le 3 mai, 8 buts en 11 matchs, le meilleur ratio européen du moment. Les quatre dernières journées furent plus difficiles, pour un Milan dilettante et peu appliqué, mais de telles statistiques sont la meilleure preuve qu’à 36 ans le joueur est toujours une référence dans son domaine.
Le jeu d’Inzaghi, si particulier, si spécifique, n’est pas des plus exigeants physiquement, d’autant que le joueur gère à merveille ses déplacements et ses efforts, à la manière de son ancien capitaine, Paolo Maldini. Unique au monde, cet avantage lui permet d’être, encore aujourd’hui, le meilleur attaquant du Milan AC, et certainement l’un des meilleurs attaquants d’Europe, ce qu’il ne manquera pas de démontrer une nouvelle fois dans sa compétition fétiche, la Ligue des Champions. Il est impensable d’aligner un autre avant-centre rossonero lors des grands rendez-vous européens, mais Leonardo devra néanmoins veiller à ne pas titulariser son homme providentiel plus d’une fois par semaine, afin d’optimiser son rendement, et de limiter les risques de blessure. Si le cas Pippo est bien géré, nul doute que les supporters rossoneri auront le plaisir de revoir souvent ces explosions de joie si singulières après un but, quelle qu’en soit la nature. Car Inzaghi aime le foot, comme peu de joueurs professionnels aiment le foot. C’est aussi pour cela qu’il est tant apprécié des tifosi, malgré un style peu académique, qui écoeure la plupart des amateurs de foot non-italiens. C’est tout le paradoxe d’un joueur passionné, aux célébrations de buts quasi-orgasmiques, qui ne parvient à passionner le spectateur neutre, adepte du football standardisé à l’esthétisme convenu.
Homme de coups, homme de coupes, Superpippo n’aura jamais réussi à s’imposer en sélection nationale. Rarement titulaire en compétition, il est toutefois auréolé du titre de champion du monde 2006, avec notamment un but au compteur contre la République Tchèque. Les sélectionneurs l’ont estimé trop atypique pour lui attribuer un autre rôle que celui, peu enviable, de joker. Pourtant, depuis la retraite de Vieri, aucun attaquant ne s’est affirmé à ce poste. Encore aujourd’hui, Inzaghi serait vraisemblablement le plus légitime sur une compétition d’un mois, mais Lippi a d’autres projets. L’hypothèse non farfelue d’une Ligue des Champions réussie pourrait toutefois faire pression sur un CT bien incapable de trouver une solution productive aux avant-postes de la Squadra jusqu’à présent.
Le football moderne

Il existerait une tendance obligatoire et incontournable, modèle absolu à appliquer à la lettre, appelée football moderne. Le concept de football moderne régirait la planète football, et ne souffrirait aucune contradiction, aucune rébellion, qui serait perçue comme un crime de lèse-majesté. Le football moderne se serait imposé naturellement comme une évidence, comme le point de départ de toute entreprise dans le monde du football d’aujourd’hui. Surtout ne pas réfléchir, le football moderne a déjà pensé le monde avant vous, et créé un système de références parfait. Toute réflexion ou action hors du système serait par définition caduque, impertinente, et hérétique. La réflexion, c’est bien connu, précède la désobéissance, donc mieux vaut ne pas s’y aventurer.
Mais qu’est-ce que le football moderne ?
Le football moderne est d’abord offensif, et exclusivement offensif. L’objectif est de marquer et d’encaisser le plus grand nombre de buts possible, afin de satisfaire les instincts d’un peuple qui pense forcément « football moderne », et pas autrement. Le nombre de buts inscrits au cours d’une rencontre en donne l’indice de qualité. Si vous proposez un jeu fermé, axé sur la défense, et la contre-attaque, vous êtes exclu du club très select du football moderne, et pointé du doigt comme le méchant, la lie de la société. Le traitement réservé en juin 2006 à l’équipe nationale d’Italie par la presse européenne illustre assez bien ce point. La Squadra, exhibant son football traditionnel aux yeux d’une presse avide de football moderne, fut la risée – jaune – de tous. Le football moderne, très bien organisé, a ses codes, ses valeurs, et tient à les faire respecter. Par exemple, la construction des offensives d’une équipe adoubée par le système passe forcément par des ailiers, et des latéraux offensifs. Le poste de milieu offensif axial, jadis numéro 10, est mort, car les théoriciens du football moderne en ont décidé ainsi, et il n’est bien entendu pas question de douter du bien-fondé de leur jugement. Les arrières latéraux ne doivent plus défendre, mais se contenter d’attaquer. Dès leur plus jeune âge, on leur enseigne les grands principes modernes qui caractérisent le poste : « courez, attaquez, centrez, mais surtout ne défendez pas, ne taclez pas, ne soutenez pas votre défense centrale. C’est pas bien, ça diminue le nombre de buts marqués au cours d’un match. »
Le football moderne est également physique, et ne tolère que des coureurs de fond. La technique, optionnelle, ne peut suffire seule, car « tout va trop vite, tout est trop dur pour un technicien pur. » Le football moderne envoie ses recruteurs superviser les compétitions d’athlétisme, car le profil de joueur recherché s’y trouve plus facilement que sur un terrain de football. Qui dit sprinter dit défenses transpercées, buts marqués, spectacle assuré, et football moderne rassasié. Le football moderne dicte également les lois qui régulent les récompenses individuelles des joueurs. Un défenseur ne peut être honoré qu’en dernier recours, si toutes les autres solutions ont été épuisées. Il est de bon ton de faire prévaloir les attaquants et les milieux offensifs sur leurs camarades porteurs d’eau, car seuls comptent les buts marqués. Chacun peut constater que le football moderne tient bien son sport, et est au départ (modelage du jeu) et à l’arrivée (récompenses) de tout processus. Le football moderne est, par conséquent, un grand spécialiste de l’autocongratulation, tout fier qu’il est de maîtriser parfaitement les rouages de son système.
Le football moderne aime beaucoup l’argent. Plus que le football, diront certains, mais ces gens ne peuvent être que jaloux de la réussite sans précédent du football moderne. Le génie du football moderne est d’avoir su créer un cercle vertueux, composé de dirigeants stars, de joueurs stars, de maillots stars, et de stades stars. Florentino Perez a consacré le football moderne via son étendard le plus brillant : le galactisme. L’objectif, atteint, était de réunir sous le même maillot le meilleur Espagnol, le meilleur Portugais, le meilleur Français, le meilleur Brésilien et le meilleur Anglais, pour flatter l’iris des futurs acheteurs de maillots. Transferts records, salaires records, et ventes records, forment la devise du dirigeant moderne, et ce, peu importe les résultats sur le terrain. Le Real a sombré, faute de collectif cohérent, mais les maillots se sont vendus, et le sieur Perez s’apprête à renouveler l’expérience avec le neogalactisme. L’Inter ou Chelsea suivent et contribuent à l’implantation de ce système pour riches en Europe, et d’autres s’inscrivent peu à peu dans la même démarche. Les clubs s’endettent, les symboles se brisent, les traditions disparaissent, la culture fond, c’est le football moderne. Si c’est moderne, c’est bien, donc il faut poursuivre dans cette voie déjà tracée par les chasse-cultures dernier cri du football moderne. Suivez les modes, pliez-vous aux saints principes et aux saintes idées du football moderne, seul détenteur de la vérité, seul guide vers bonheur.
Bien entendu, le football moderne ne s’encombre pas de restrictions aberrantes : pour le football moderne, il n’existe ni pays, ni nations, ni terres, ni peuples, ni langues, ni frontières, ni cultures. Ces notions désuètes n’ont plus leur place dans le monde merveilleux du football moderne. Il n’y a qu’un monde, qu’un modèle de jeu transcendant, qui fait fi de tout le reste, tant que l’argent coule à flot. L’objectif ultime du football moderne est d’ailleurs de s’affranchir du lourd fardeau que constituent les pauvres. Le projet Superleague permettrait d’extraire les clubs les plus riches de leur environnement national pour les confronter dans un tournoi idéal, fait de paillettes, de pubs télé et de maillots dorés couverts de sponsors. Le FC Nutella rencontrerait le Destop AC au stade Lotus, pour le plus grand bonheur de tous. Il va de soi que les superstars du ballon rond n’auraient plus de temps à consacrer à leur équipe nationale, si elles existent encore. Leur suppression n’est pas à exclure, car elles constituent un frein encombrant à l’expansion du football moderne.
Ainsi va le football moderne, fort de sa raison, de sa vérité, de son règne.
Le 6 + 5
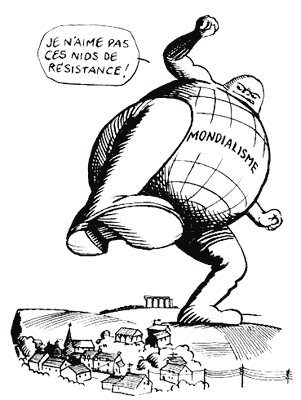
Avant 1996, les clubs de football ne pouvaient aligner plus de trois étrangers sur une feuille de match. L’arrêt Bosman a permis d’abolir les quotas, et d’appliquer au football le principe de libre circulation des travailleurs, gravé dans le marbre par l’article 39 du traité de Rome. Les raisons de la polémique sont en réalité plus liées à ce que les dirigeants des grands clubs européens ont fait de cette liberté nouvelle qu’à la liberté elle-même. En effet, jamais l’arrêt Bosman n’a enjoint les clubs à tourner le dos aux jeunes locaux, ni à faire de cette liberté un système exclusif. L’arrêt Bosman a rendu quelque chose possible, mais possibilité ne veut pas dire obligation, ni extrémisme. Or, depuis quelques années, il n’est pas rares de voir des ténors du football européens évoluer avec un, voire deux nationaux seulement, chose qui n’existe pratiquement pas dans les autres corps de métiers. Le Français moyen ne sera pas surpris de constater qu’il est majoritairement entouré de Français, au travail, dans la rue ou au supermarché. Ca ne le choquera pas particulièrement, et il ne sera pas immédiatement pris d’une brusque envie de qualifier son pays de nationaliste, voire de raciste. Le monde du football est quelque peu différent, et certaines réactions à l’annonce du projet 6 + 5 sont très clairement hors sujet. Ni Platini, ni les ministres des sports européens, ne souhaitent encourager la hiérarchisation des races ou interdire le métissage.
Le Big Four anglais, vitrine actuelle du football européen, vanté comme l’idéal, la référence absolue, serait, comme l’Inter Milan ou le Real Madrid, fortement mis à mal par un vote rapide du 6 + 5. Le fameux Liverpool-Chelsea du 14 mai dernier est un exemple assez révélateur de la tendance actuelle des clubs fortunés : deux Anglais chez les Blues (Cole et Lampard), et un seul, Carragher, du côté des Reds. Les absences de Terry et Gerrard ne changent pas grand-chose au problème. Arsenal, club londonien, donc théoriquement au beau milieu d’un des plus grands viviers de footballeurs en Europe, persiste à snober les jeunes Anglais, même si Theo Walcott est récemment venu jouer le rôle de l’exception. L’entraîneur des Gunners est, sans surprise, l’un des plus grands opposants au 6 + 5, à l’inverse, par exemple, d’Alex Ferguson, vainqueur de la Ligue des Champions 2008 avec un 11 type à majorité anglaise. Ce dernier déclarait, le 17 décembre dernier : Je pense qu'il y a lieu d'être inquiet quand on ne donne pas leur chance à des joueurs de la région ou du pays. En conséquence, je pense qu'il faut une limitation du nombre de joueurs étrangers dans chaque club. C'est comme ça qu'on protégera le système de formation des clubs.
Le football anglais mène la danse, et les autres suivent. Le Real galactique a montré ses limites, mais le retour de Perez semble annoncer un renouvellement de l’expérience. La définition du galactisme est, rappelons-le, l’association sous le même maillot des meilleurs joueurs de chaque grand pays de football, via des dépenses et dettes colossales. La somme d’individualités, la juxtaposition de talents, est censée produire un collectif efficace et rapporter des titres. Le théorème de Perez a pourtant bien montré ses limites il y a quelques années, mais il en faut plus pour dissuader les grands financiers qui se pavanent à la tête des clubs en question. Il s’agit pourtant de l’un des principes élémentaires du football : la construction d’un collectif efficace nécessite cohérence et cohésion. Les meilleurs joueurs du monde ne parlent pas nécessairement le même football, et n’entrent pas non plus toujours dans un schéma tactique donné, si tant est qu’on puisse parler de schéma tactique à propos du Real galactique.
En Italie, la résistance a duré plus longtemps, sauf à l’Inter. Moratti a créé une sorte de Chelsea du pauvre, jouant les premiers rôles en Italie, mais inapte à la Ligue des Champions. Les intégrations récentes de Santon et Balotelli tranchent avec la philosophie habituelle du club, et préfigurent peut-être un revirement inattendu.
La Juve a toujours cultivé son italianité, et le Milan a longtemps été pris entre deux eaux. Après avoir remporté deux Ligues des Champions avec des équipes à majorité italienne, le club rossonero semble en voie d’intérisation. Le remplacement de Maldini par Thiago Silva et l’intronisation de Leonardo au poste d’entraîneur sont deux premiers signes forts, confirmés par les transferts annoncés ces dernières semaines. Quelques italiens viennent grossir les rangs de la primavera, mais en équipe première, seuls les retours de prêt de Oddo (contraint et forcé), Di Gennaro et Abate font office de cache-misère. Abbiati, Zambrotta, Ambrosini et Pirlo devraient être titulaires cette saison. Quant à Gattuso et Nesta, tout dépendra de leur condition physique. Tous trentenaires, ces joueurs sont les arbres qui cachent la forêt, car, comme Maldini, ils n’ont que très peu de chances d’être remplacés par des Italiens à l’avenir. Et pourtant, les Rossi et autres Cigarini ont publiquement crié leur amour pour le Milan ces derniers mois, mais Galliani n’en eut cure.
Les sélections italiennes espoirs brillent pourtant régulièrement sur la scène internationale, et quelques jeunes, comme Marchisio, De Ceglie, Giovinco, Santon, Balotelli ou Motta ont déjà eu l’occasion de prouver leur valeur dans des clubs italiens huppés. Mais Bocchetti joue au Genoa, tout comme Criscito ; Cigarini vient de signer à Naples, et Acquafresca est prêté à l’Atalanta … en sachant que les deux premiers cités ont le niveau pour être titulaires au Milan, que Cigarini serait le regista idéal, et qu’Acquafresca est le profil d’attaquant recherché par le club de Berlusconi . Et nous ne parlons que de joueurs connus du grand public. Le drame est que, faute de perspectives, de nombreux jeunes talents changent d’orientation, ou restent stagner dans les divisions inférieures. Ces mêmes jeunes, qui, il y a une quinzaine d’années, bénéficiaient de l’ascenseur social italien, en passant du Torino au Milan AC, ou de Cremonese à la Juventus, sont aujourd’hui ignorés par des entités financières en quête de merchandising et de marchés asiatiques. Pour justifier tout cela, le système a ses arguments phares, pourtant assez facilement réfutables :
- Le spectacle, qui serait incompatible avec le terroir. Question de point de vue ...
- La présumée baisse de niveau des jeunes Européens : là encore, argument irrecevable, car les faits démontrent le contraire ;
- Le prix soi-disant plus élevé des nationaux … certainement pas en Italie ;
- Les stars étrangères vendraient plus de maillots. Il est assez peu vraisemblable que Del Piero ait moins vendu que Shevchenko, ou que Kaladze ait plus vendu que Maldini. En réalité, on sait surtout que les attaquants vendent mieux que les défenseurs, et qu’en Italie, on recrute traditionnellement nos attaquants à l’étranger, car le label rouge italien s’applique à d’autres postes.
Pour résumer brièvement, nous constatons :
1) Qu’il n’est pas moins risqué d’intégrer un jeune du pays qu’un –inho déraciné, au contraire ;
2) Que la baisse de niveau des clubs italiens coïncide avec le processus de désitalianisation, et avec l’abandon de nos spécificités tactiques historiques ;
3) Que le phénomène d’exclusion des jeunes italiens est une réalité ;
4) Que la Nazionale connaît une crise sans précédent, y compris en défense, fait rarissime, pour ne pas dire unique depuis au moins trente ans.
Le 6 + 5 est-il la solution miracle ? Sur ce point, les avis sont partagés. Certains croient à une réaction efficace spontanée des dirigeants de clubs, mais d’autres pensent que rien ne changera sans loi, car les intérêts financiers et sportifs ne concordent pas toujours. Le 6 + 5 est probablement nécessaire, mais il devra quoi qu’il arrive être accompagné d’autres mesures économiques intelligentes, permettant de réguler un système de plus en plus orgiaque.
Quel avenir pour la Squadra ?

Quelques jours après la victoire attendue du Brésil à la Coupe des Confédérations, il est grand temps de faire un bilan de la prestation italienne lors d’une compétition à l’origine censée permettre aux participants de se roder en vue de la Coupe du Monde. Nous attendions des essais, des nouvelles têtes, un schéma tactique clairement défini, et surtout une Squadra digne de son rang. Cette dernière, souvent démobilisée en l’absence d’enjeu, n’a malheureusement pas dérogé à la règle : une victoire sur le fil contre des Etats-Unis réduits à dix, et deux défaites, dont un cinglant mais prévisible 0-3 face au Brésil. Peu d’essais, si ce n’est le virevoltant Rossi ; peu de confirmations, si ce n’est, par exemple, la médiocrité de Legrottaglie ; et encore moins de satisfactions. Il est vrai que le championnat d’Europe espoir avait lieu au même moment en Suède. Nous pûmes donc admirer les Bocchetti, Cigarini, Criscito, Marchisio, De Ceglie et autres Giovinco, en regrettant amèrement leur absence en Afrique du Sud, au profit de sénateurs apathiques.
Devons-nous attribuer l’échec de l’équipe A à l’absence de motivation des cadres ? A la fatigue ? Ou bien, plus simplement, à la baisse de niveau flagrante des champions du monde en titre ? Disons que les trois éléments réunis constituent une explication plausible. La faillite de l’Espagne et les difficultés du Brésil tendraient à appuyer la thèse numéro un, mais la situation est trop préoccupante pour se contenter d’une justification aussi rapide et peu évidente. Avant d’aborder les lacunes individuelles, concentrons-nous sur les trois aspects les plus frappants, en commençant par le schéma tactique.
La tactique est historiquement le grand point fort de la Nazionale, et Lippi n’est pas novice en la matière. Or, le 433 actuel semble inadapté et contreproductif, pour plusieurs raisons :
- L’absence d’ailiers de débordement, si l’on excepte un Camoranesi amorphe ;
- La nécessité de protéger la défense italienne la plus faible depuis trente ans ;
- Le truisme qui veut que l’Italie n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle joue défensif, avec notamment un milieu renforcé, travailleur, et complet. Lors de la dernière Coupe du Monde, au terme du match nul contre les Etats-Unis, le capitaine Cannavaro avait publiquement réclamé le retour du cynisme à l’italienne, et d’un jeu prioritairement axé sur la défense. Il l’obtint, et la Squadra retrouva des couleurs, en renouant avec le succès suprême, vingt-quatre ans après.
Le deuxième gros point noir est l’absence totale de percussion, de vitesse, et de changements de rythme. Si l’Italie a l’habitude de s’appuyer sur une défense solide, elle n’oublie jamais de mener des contres ultra-rapides et efficaces, avec la vitesse d’exécution appropriée. Cet aspect fondamental du jeu italien semble avoir été négligé par un sélectionneur trop sûr de lui et de ses champions du monde, trois ans après . Problème d’âge ou de joueurs ? Le seul à avoir su tirer son épingle du jeu dans ce domaine est Rossi, ce qui n’aura surpris personne. Signalons également la bonne entrée de Pepe contre le Brésil. L’insertion progressive de Giovinco, voire le retour de Di Natale, pourrait partiellement résoudre le problème, et améliorer la liaison milieu-attaque, si déficiente aujourd’hui. Des joueurs comme Abate ou Foggia sont à surveiller également, s’ils bénéficient d’un temps de jeu satisfaisant la saison prochaine, ce qui est loin d’être gagné pour le premier. L’énigme Cassano reste d’actualité, et nous amène à notre troisième point : l’entêtement d’un sélectionneur jusqu’au-boutiste.
Depuis de nombreuses années nous avons droit à des sélectionneurs italiens têtus et bornés, qui préféreraient mourir avec leurs idées qu’en changer. Cesare Maldini, Dino Zoff et Trapattoni ont passé le flambeau à Lippi, qui persiste à snober les deux meilleurs joueurs italiens du moment : Cassano et Ambrosini. Le premier aligne les chefs-d’œuvre avec la Samp chaque weekend, et le second est tout simplement le meilleur milieu de terrain italien depuis deux ans. Le cas Ambro est par ailleurs bien moins compréhensible que l’exclusion de la tête brûlée barese, car le nouveau capitaine du Milan AC est exemplaire sur et en dehors du terrain. Jamais le CT n’a justifié la non-sélection du numéro 23 milanais. Pire, il lui préfère son compère Gattuso, totalement hors de forme, après quatre mois de blessure et seulement quelques minutes de jeu contre la Fiorentina lors de la dernière journée. En plus de présenter des caractéristiques uniques et cruellement absentes dans l’entrejeu azzurro, captain Ambro est d’une régularité métronomique. Tous ceux qui ont pris le temps et la peine de visionner les trois matchs de la Squadra en Afrique du Sud ont aisément pu constater l’absence frappante d’implication, de hargne, de combativité du milieu de terrain italien. Comment ne pas immédiatement songer à Ambrosini en pareilles circonstances ? Lippi a moins d’un an pour changer de lunettes.
Venons-en maintenant aux joueurs, ligne par ligne. Force est de constater que Buffon n’a jamais retrouvé son véritable niveau depuis son retour de blessure il y a quelques mois. Ce sera probablement le cas après une bonne préparation physique cet été, et celui que tout le monde ou presque considère depuis des années comme le meilleur gardien du monde devrait être un pilier de la sélection dans un an. Sa doublure officielle, Amelia, est un bon gardien, malgré une prestation catastrophique contre la Nouvelle-Zélande en amical il y a quelques semaines. Abbiati pourrait réintégrer le groupe s’il continue son excellente série milanaise.
Lé défense fait partie des principaux chantiers, malgré les certitudes de Lippi. Une Italie sans défense n’existe pas. Or, ce qui fut la force historique de la Squadra est aujourd’hui l’une de ses principales faiblesses. Les raisons sont connues, mais ne seront que très brièvement évoquées dans cet article, en attendant la prochaine émission de CasaMilan et le fameux débat sur le 6+5. Cannavaro, capitaine depuis le départ de Maldini en 2002, n’a tout simplement plus sa place dans cette équipe, et a de grandes chances d’être le Thuram 2008 de la Squadra si rien n’est fait d’ici le début du Mondial. Sa blessure avant le dernier Euro n’a fait que retarder l’échéance. Plus lent, moins réactif, il a montré ses limites au Real comme lors de cette Coupe des Confédérations. Son compère Chiellini était théoriquement la valeur sure de l’équipe, et s’est troué à plusieurs reprises, dès le premier match, en provoquant un pénalty en faveur des Etats-Unis. Si le niveau réel du joueur est bien au-delà de ce qu’il a montré il y a quelques jours, l’inquiétude n’en est pas moins grande, d’autant que le banc des remplaçants ne compte aucun défenseur central de qualité. Legrottaglie n’a jamais eu le niveau pour jouer les premiers rôles en club, donc encore moins en sélection, et Gamberini n’est qu’un bon défenseur de devoir, inapte au niveau international. Un retour de Barzagli, champion d’Allemagne avec Wolfsburg, n’est pas à exclure, même s’il reste sur un échec retentissant contre les Pays-Bas en 2008. Bocchetti et Criscito (même si ce dernier passe le plus clair de son temps à gauche depuis plusieurs mois) pourraient faire leur apparition assez rapidement, et n’auraient vraisemblablement aucun mal à s’imposer face aux menhirs fissurés qui tiennent le poste en ce moment. Sur les ailes, les éclosions de Motta et Santon vont sérieusement menacer Grosso et Zambrotta, même si ce dernier reste un très grand défenseur lorsqu’il est au top de ses moyens physiques. En revanche, Dossena n’a pas, et n’a jamais eu le niveau pour faire partie du groupe. Remplaçant à Liverpool, le joueur n’a plus rien à faire sous le maillot azur.
Au milieu les choses sont relativement simples : tout dépend de l’état de forme des titulaires. En pleine possession de leurs moyens physiques, Gattuso, Pirlo et De Rossi forment un milieu efficace et complémentaire. Le premier devra énormément travailler cet été pour répondre aux exigences d’une saison qui s’annonce éprouvante pour les Rossoneri, avec notamment le retour de la Ligue des Champions. La comparaison avec Ambrosini risque d’être assez lourde et révélatrice dans les mois qui viennent. Le Romain, plus jeune, semble le mieux armé pour tenir le rôle de regista, en sachant qu’il a toujours été très irrégulier en sélection, y compris lors des derniers matchs. Pirlo reste le génie de la Squadra, capable à tout moment de débloquer les situations les plus inextricables. Les trois minutes d’arrêts de jeu contre les Etats-Unis furent éloquentes sur ce point : trois balles de but données à Rossi et Toni, dont une transformée par le premier. Le problème est qu’un Pirlo sans récupérateurs performants, ni attaquants mobiles, ne sert à rien. En 2006 Lippi avait construit une équipe autour du meneur de jeu milanais, avec des résultats concluants. Il devra vraisemblablement faire de même dans un an. Palombo, provisoirement remplaçant officiel de Gattuso, semble trop limité pour jouer les premiers rôles dans cette équipe ; Montolivo doit encore progresser, et surtout faire preuve de régularité ; et Aquilani est bien trop fragile pour prétendre à quoi que ce soit. Restent les jeunes : De Ceglie, Marchisio et Cigarini, promis à un grand avenir, mais la situation de leurs clubs sera déterminante.
En attaque, les buteurs se font rares depuis la retraite internationale de Vieri. Toni n’a jamais confirmé, et sort d’une saison désastreuse avec son club ; Gilardino est trop tendre pour le niveau international, et Iaquinta n’a jamais été un pur attaquant de pointe. Pazzini pourrait être l’homme providentiel, même s’il faudra également garder un œil sur les espoirs Acquafresca et Balotelli, en admettant que ce dernier s’achète une conduite. A l’heure actuelle, si surprenant que ça puisse paraître, le meilleur buteur italien en activité s’appelle Pippo Inzaghi. Auteur d’une deuxième partie de saison remarquable, il ne paraît pas marqué par le poids des ans, et pourrait parfaitement postuler à une place de joker à la Coupe du Monde. Après tout, la qualité et la forme du joueur sont censées primer sur son âge.
En soutien, les solutions les plus intéressantes sont probablement Giovinco, Rossi et Cassano. Pepe est trop laborieux, Iaquinta trop approximatif et irrégulier, et Camoranesi trop rarement convaincant en sélection. Del Piero semble hors du coup, ce dont les supporters de la Squadra ne pourront que se féliciter, tant le décalage a toujours été immense entre ses prestations en club et en sélection.
L’opération la plus délicate sera certainement l’organisation de tous ces talents, et la gestion des états de forme. Mais, comme nous l’avons noté, il ne faudra pas nourrir de trop grands espoirs pour la Coupe du Monde si l’Italie ne construit pas dans les plus brefs délais une défense imperméable. C’est la clef de la réussite. Dernier point essentiel : aucun renouvellement efficace ne pourra avoir lieu si les gros clubs italiens continuent de mépriser les jeunes. Ce sera l’objet de la prochaine émission de CasaMilan, dans quelques jours …
Les arrêts de jeu d'Italie-USA, avec Pirlo à la baguette :
Baggio et moi

En 1990, âgé de neuf ans, j’ai entraperçu chez un ami les images de la chevauchée fantastique d’un numéro 15 au maillot azur, au cours d’une compétition sportive que les grandes personnes appelaient Coupe du Monde de football. Or, à l’époque, le football n’était pour moi qu’un jeu de cour de récréation, que je pratiquais avec la maladresse du gamin dénué de talent qui n’a d’autre leitmotiv que de suivre ses camarades en tâchant tant bien que mal de faire bonne figure. Je changeais systématiquement de chaîne lorsqu’il m’arrivait de tomber sur du foot à la télé, et rien dans ce sport n’éveillait en moi un quelconque engouement, une quelconque passion. Cette action de jeu contre la Tchécoslovaquie, si furtive qu’en fût sa perception, devait pourtant rester gravée dans mon inconscient, et resurgir soudainement dans ma mémoire trois ans plus tard. Aujourd’hui j’ai compris qu’elle avait conditionné une bonne partie de ma courte existence, et sans nul doute façonné la conception immuable d’un sport qui me laissait autrefois indifférent. Il faut reconnaître qu’elle était belle, cette action : faite de classe et d’élégance, de savoir-faire et de précision, mariage rare de spectacle et d’efficacité. Départ de la ligne médiane, côté gauche ; hommage au collectif via un une-deux parfaitement exécuté, afin de mettre dans le vent deux adversaires ; puis l’artiste peut entrer en action, et s’envoler vers une première consécration : une simple touche de l’extérieur du pied droit suffit pour éviter le tacle d’un joueur tchécoslovaque ; puis, dans la surface de réparation, une feinte de corps permet de prendre à revers le dernier opposant, et d’ajuster tranquillement, sans chercher à surjouer, le gardien adverse, du plat du pied. Les quatre qualités du grand footballeur y sont : physique, car il s’agit d’une course de cinquante mètres ; tactique, car le positionnement et l’inspiration du une-deux est judicieuse et concluante ; technique, d’évidence ; et mental, pour l’initiative et la conception d’un chef-d’œuvre.
En 1993 bien des choses avaient changé. A des centaines de kilomètres du lieu de l’exploit, dans un pays où le football italien est régulièrement conspué, méprisé, voire ignoré, j’avais fini par adopter ce nouveau jeu, sans doute influencé, comme beaucoup d’adolescents, par ce que les Anglais appellent « peer pressure ». Les exploits du duo Ginola-Weah m’avaient convaincu, presque enchanté, et c’est en supporter du PSG que j’abordais une délicate demi-finale de Coupe de l’UEFA contre la Juventus de Turin. Paris venait d’éliminer avec brio le grand Real Madrid, avec un but extraordinaire de mon idole de l’époque, somptueuse demi-volée sous la barre du gardien madrilène. L’équipe des Roche, Lama, Le Guen, Valdo, Guérin et cie allait forcément remporter la compétition, c’était l’évidence même pour l’ignorant que j’étais. Mais mon club et moi allions prendre une grande leçon de football, de sobriété, d’efficacité, d’humilité. Dès le début du match, chacun pouvait sentir que quelque chose n’allait pas sans toutefois parvenir à en déterminer la cause. Pourtant, Paris ouvrit le score, mais rien n’y fit. Mon équipe semblait étouffée, condamnée à soigner la forme plus que le fond, face à une équipe d’apparence plus faible, car moins flamboyante, mais en réalité nettement plus sure d’elle, et surtout privilégiant la fin aux moyens. Ce soir-là j’ai appris ce qu’était le vrai football : maîtrise des zones de vérité, gestion sereine et utilitariste, individualité au service du collectif, et cynisme ravageur. Bien que d’apparence cruelle pour l’adversaire défait, ces valeurs m’ont séduit, et ne m’ont jamais quitté. Plus important : ces deux soirs de désillusions parisiennes m’ont également permis de mettre un nom sur l’image furtive de 90. En effet, après quelques minutes de jeu, j’ai été frappé par l’allure et la conduite de balle du numéro 10 turinois. Cette classe, cette élégance, ce jeu de corps si singulier, … le catogan avait poussé, mais je ne fus pas long à faire le lien avec l’action floue de la Coupe du Monde, qui reprenait vie dans ma mémoire. Ce joueur, qui allait être nommé Ballon d’Or 1993, s’appelait Roberto Baggio.
Ce nom incarne à lui seul l’Italie et ses attraits. A la rondeur des caractères et des sonorités semble correspondre la finesse et la fluidité des mouvements du joueur, d’un tableau de Michel-Ange, ou de l’art florentin renaissant. C’est à Florence, l’une des plus belles villes d’Italie, que le jeune Baggio fit ses premières armes, connut sa première blessure grave, et provoqua sa première émeute, lors du départ vers la Juve. Avec 115 buts en 200 apparitions sous le maillot bianconero, il divin codino franchit un pallier supplémentaire, et fut rapidement considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde. Son aisance technique et son toucher de balle unique en firent l’un des favoris des médias du monde entier. Bien avant le début de la Coupe du Monde américaine, la presse en avait déjà fait l’une des stars du tournoi, et, malgré les horaires parfois contraignants, je pus enfin vraiment admirer le joueur de façon suivie. En effet, au début des années 90 les chaînes françaises ne diffusaient que très peu d’images des clubs étrangers, sauf quand ces derniers croisaient le fer avec nos clubs lors des différentes coupes européennes. Par conséquent, les compétitions internationales étaient des occasions uniques de voir les meilleurs joueurs de la planète s’affronter. Pourtant la compétition commença très moyennement pour la Squadra. Après une défaite contre l’Irlande, le match contre la Norvège était déjà décisif. Or, à la 21ème minute, Pagliuca manqua sa sortie, et commit une faute de main à l’extérieur de sa surface de réparation. La sanction fut terrible et logique : carton rouge, et l’Italie réduite à 10. Sacchi décida alors de sortir son meilleur atout offensif, à la grande surprise de Roberto lui-même, et des commentateurs italiens, dont le célèbre « Esce … esce Roberto Baggio » traduisit la stupeur immédiate. L’Italie s’imposa finalement 1-0, et se qualifia, comme souvent, sans la manière, après un nul peu flatteur contre le Mexique. La vraie compétition allait alors commencer, et Baggio se rappeler au bon souvenir de Sacchi et de ses admirateurs.
Le huitième de finale contre le Nigeria de Yekini s’annonçait difficile. Physiquement très supérieurs, et techniquement en progrès constants, l’équipe africaine faisait figure de piège, et ne cachait pas son objectif : reproduire les exploits camerounais de quatre ans auparavant. L’ouverture du score d’Amunike en première mi-temps confirma les craintes d’avant-match, et les observateurs de l’époque ont longtemps cru l’Italie incapable de redresser le barre, d’autant que ce qu’elle avait montré jusqu’à présent ne plaidait pas en sa faveur. C’était oublier l’histoire ; c’était sans compter sur les ressources mentales et tactiques d’une équipe à l’ossature milanaise ; et c’était surtout occulter le génie qu’elle comptait sur le front de l’attaque. A la 88ème minute, Roberto reçut un bon ballon de la droite, et, d’un calme absolu, plaça de l’entrée de la surface de réparation, du plat du pied droit, une balle ultra-précise au ras du poteau gauche du gardien nigérian. L’Italie arrachait la prolongation, et prenait le chemin du succès. A la 102ème minute, le meneur de jeu italien transforma le pénalty de la victoire, expédié dans le même coin gauche des buts adverses. L’Italie était en quart de finale, et le tournant psychologique tant attendu avait bien eu lieu, grâce au stratège adulé par une nation en ébullition, quatorze ans après son dernier titre mondial. Comme Paolo Rossi en 1982, Baggio allait être décisif lors des matchs à élimination directe. L’Italie, si prompte à se faire désirer, si encline à s’acculer d’elle-même au mur, à se laisser pousser dans ses derniers retranchements, à laisser croire, à laisser espérer, si dramaturge en ses plus belles heures, venait de me donner mes premiers frissons de supporter de football. La solution devait venir de Baggio, je n’en doutais pas, mais que ce fut long ! Le génie avait pris le temps de peaufiner son œuvre, d’ajuster les derniers détails du fruit de son inspiration, d’offrir à son public à la fois le suspense et la délivrance, l’intrigue et le dénouement, l’énigme et sa résolution, qui n’en devenait que plus jouissive et passionnelle. Ce plaisir du désir tardivement assouvi, cet art consommé de la fourberie, cette ivresse de l’attente récompensée, était – je l’ai appris par la suite – une vraie spécialité italienne.
Dès le tour suivant la Squadra conforta cette opinion. Face à des Espagnols revanchards, quelques semaines après l’humiliante correction infligée par le Milan de Capello aux Barcelonais de Cruijff, la Squadra ne tarda pas à ouvrir le score grâce à Dino Baggio, mais un but contre son camp de Benarrivo entretint le suspense – encore – jusqu’à la 88ème minute. Aux trente mètres, Beppegol Signori envoya de son pied gauche magique un superbe ballon à Baggio, prenant ainsi à revers une défense très espagnole. D’un dribble de l’extérieur du pied droit, ce dernier élimina facilement Zubizarreta, mais s’excentra dangereusement. Tout un peuple retint alors son souffle, et, l’espace de quelques centièmes de seconde, se demanda comment son homme providentiel pourrait redresser son ballon, et résister au retour des défenseurs espagnols. Mais Baggio, passé maître en trajectoires irréelles et sublimes, crucifia l’Espagne d’une frappe diaboliquement précise, entre le poteau droit et le dernier défenseur. Quatre ans après, l’Italie accédait une nouvelle fois en demi-finale, et faisait taire ses détracteurs les plus virulents. Baggio avait arrêté le temps quelques instants, suspendu au sigle jaune fluo des célèbres Diadora plusieurs millions de téléspectateurs. L’Italie n’avait d’yeux que pour lui, oubliant injustement les grands matchs des Maldini, Albertini, Costacurta, etc. Comme en 1986, une équipe était résumée à un seul de ses membres. Après Maradona, Baggio. Le monde du football a toujours abusé de la synecdoque, mais la tentation était trop grande ! J’étais conquis, et je pense pouvoir dire qu’à ce moment précis j’ai commencé à adorer le football. Ce sport, si quelconque quelques années auparavant, était en train de me passionner, de me coopter. Je pouvais enfin comprendre et expliquer le phénomène, car j’avais eu ma révélation. Finalement, comme la presse et les supporters italiens, je ne craignais qu’une seule chose : la blessure de Baggio. Réputé fragile depuis l’épisode de la Fiorentina, le joueur était choyé par le staff médical azzurro, mais nous savions tous qu’il n’était pas à l’abri des tacles assassins d’un Ivanov, par exemple.
A la 71ème minute d’Italie-Bulgarie, Signori entra en jeu à la place de Baggio, blessé … et l’équipe médicale azzurra entama une course contre le temps, car il n’était pas question d’envisager un quelconque avenir sans celui qui venait encore de qualifier son équipe pour la finale. En effet, tout avait bien commencé. Dès la 21ème minute le stratège italien avait marqué l’un des plus beaux buts de la compétition : touche de Donadoni sur la gauche, contrôle orienté de Baggio qui mit dans le vent deux adversaires bulgares, puis, à nouveau, dribble de l’extérieur du pied droit pour se jouer du tacle de l’avant-dernier défenseur, et travailler de l’intérieur du pied droit une merveille de balle enveloppée qui finit sa course au ras du poteau droit bulgare. Le tout effectué à l’extérieur de la surface de réparation. Quatrième but de Baggio en trois matchs, sur les cinq marqués par son équipe. Et quatre minutes plus tard, sur une superbe balle piquée d’Albertini, il divin codino, décalé sur le côté droit, trouva le petit filet opposé du capitaine Mihailov. Le pénalty de Stoitchkov n’y changea rien, le match était déjà plié. Ultime présent offert à son équipe et à son public avant d’être lâché par son genou droit. Le bon sens interdisait tout espoir de voir Baggio démarrer cette finale rêvée face au Brésil. Jusqu’au matin du match, personne ne savait si le joueur serait présent, mais était-il bien raisonnable de risquer l’intégrité physique du ballon d’or en titre ? Raisonnable, non, mais nécessaire, oui. Le drame de Baggio est qu’il avait su se hisser à la hauteur des plus grands, se rendre indispensable, et que sa seule présence, même sur une jambe, avait une influence cruciale sur ses coéquipiers. En d’autres circonstances, jamais Baggio n’aurait foulé la pelouse ce jour-là ; mais l’enjeu était trop important, et sa présence capitale. Après deux heures de souffrance en début d’après-midi sous quarante degrés, celui qui avait mené son équipe à ce stade de la compétition manqua le tir au but décisif. D’aucuns diront qu’il n’aurait jamais dû tirer. Les échecs de Baresi et Massaro ne sont pas restés dans les livres d’histoire. Le sien oui, et c’est ce qu’il l’a privé du titre suprême, d’un deuxième ballon d’or consécutif, et d’une postérité digne d’un Pelé ou d’un Maradona. Dramaturges dans l’âme, ces Italiens …
La saison 94/95 de Baggio fut probablement la plus surprenante. Blessé à ce même genou droit de longues semaines en milieu d’année, il n’en fut pas moins décisif, en marquant notamment d’une jolie tête le but de la victoire contre Milan, et en cumulant un nombre impressionnant de passes décisives. Son retour en fin de saison fut déterminant dans la conquête du titre, et l’annonce de son départ pour le Milan déchaîna les supporters bianconeri, dont la passion pour le capitaine courage, alors emblème de la Vecchia Signora, ne cessait de croître. Mais la fragilité de Baggio, quelques mois après l’annonce de l’arrêt forcé de Marco Van Basten, faisait craindre le pire aux dirigeants turinois, qui bravèrent la furie des supporters en cédant le meilleur joueur du monde au rival de toujours . Dois-je préciser que je supportais déjà le Milan AC, et que l’arrivée en son sein de mon joueur favori était aussi inattendue que bienvenue. Champion d’Italie en titre, Roby allait renouveler l’expérience en rossonero la saison suivante. Moins perturbé par son genou, il fut l’un des joueurs clefs de Capello, avec 28 apparitions. Je retiens pour ma part le sublime coup franc inscrit à la 74ème minute du match aller contre Bordeaux, en quart de finale de la Coupe de l’UEFA. Coup franc légèrement désaxé sur la droite, en principe réservé aux gauchers. Savicevic pressenti, mais Platini, aux commentaires, annonça Baggio dans la deuxième lucarne. Incrédule, car j’avais anticipé la lucarne droite, je vis la prédiction de Platoche se réaliser : le numéro 18 milanais brossa à la perfection ce qui devint une magnifique feuille morte, plongeant dans la lucarne opposée de Gaétan Huard. Moi qui tirais – et bien – les coups de pied arrêtés dans mon équipe de l’époque, j’ai essayé un nombre incalculable de fois de reproduire le geste, sans succès. Pourtant, j’avais les mêmes chaussures ;-)
Baggio a toujours l’air espiègle, malicieux d’un enfant, lorsqu’il s’apprête à tirer un coup franc. Loin des calculs mathématiques d’autres joueurs plus laborieux, son attitude s’apparente plus à celle du créateur, de l’inventeur sur le point de réaliser une œuvre d’art, dont il sera fier par la suite. La frappe sera précise, personne n’en doute ; cette question est dépassée depuis longtemps. Non, il s’agit plus de défier les certitudes du spectateur, ainsi que les lois physiques élémentaires. Baggio n’évolue pas dans un cadre, mais dans une sphère qu’il définit et module à sa guise. Il dessine les contours de ses trajectoires à la manière d’un peintre romantique, qui recréerait perpétuellement sa propre humanité sur une fresque sans fin. L’effet de surprise est tel que l’invention se suffit à elle-même, et touche au but sans nul besoin de puissance. J’ai toujours été marqué par ces caractéristiques propres à lui seul, et j’enjoins chacun à revisionner quelques coups francs du joueur, comme celui de la finale de Coupe de l’UEFA contre Dortmund pour n’en citer qu’un.
La deuxième saison de Roberto à Milan fut moins enthousiasmante que la première. Toujours handicapé par son genou, il n’a de surcroît pas réellement bénéficié de la confiance de l’entraîneur uruguayen Tabarez, limogé au profit de Sacchi dès le mois de septembre. Ce dernier n’a jamais pardonné à Baggio le pénalty manqué de 1994, et le snoba dès son arrivée. Or, le joueur n’avait pas participé à la débâcle italienne de 1996 en Angleterre, et tenait à faire son grand retour en sélection, d’autant que la pression populaire en sa faveur n’avait jamais cessé. Afin de se refaire une santé, et d’évoluer dans un environnement plus serein, il s’en alla faire une pige à Bologne, et y réalisa une grande saison, en marquant notamment 22 buts en 30 matchs, et en terminant troisième du classement des buteurs, derrière Bierhoff et Ronaldo, mais devant Batistuta et … Del Piero, grand rival et ami en sélection. Cesare Maldini ne pouvait l’ignorer, d’autant que la presse et le peuple se sont chargés de le lui rappeler chaque jour pendant plus d’un an. C’est ainsi que, quatre ans et deux sélections après ses exploits de 1994, Roberto Baggio fut rappelé sous le maillot azur, et s’apprêta à jouer sa troisième Coupe du Monde consécutive. Mais les rôles avaient été inversés entre-temps, et Del Piero, malgré un premier échec lors de l’Euro anglais, fut clairement désigné titulaire par le C.T. Pourtant la presse persistait à soutenir que les deux génies italiens pouvaient parfaitement être alignés côte à côte, et évoluer ensemble derrière l’intouchable Vieri, lui-même auteur d’une grande saison en Espagne, avec 24 buts marqués en 24 rencontres. Les journalistes rapportèrent que les tests physiques de Baggio lors du stage étaient supérieurs à ceux de 1994. Le débat n’a d’ailleurs jamais porté sur sa titularisation, cause acquise bien longtemps auparavant, mais sur la présence ou non de Del Piero à ses côtés. Mais l’histoire dit que les sélectionneurs italiens sont têtus, et préféreront mourir avec leurs idées qu’en changer. Maldini n’en démordit pas, et Baggio ne partirait titulaire contre le Chili que pour pallier l’absence de Del Piero, convalescent suite à une récente blessure.
Le 11 juin 1998, au Parc Lescure, Baggio retrouva donc son statut de maestro de la Squadra Azzurra, tout de blanc vêtu pour l’occasion. Tout un symbole, comme si le drame de 1994 avait été effacé, comme si le joueur s’était refait une virginité, une nouvelle jeunesse. Le tir au but, les problèmes récurrents au genou, les critiques virulentes de Sacchi, étaient oubliées, et une nouvelle épopée pouvait commencer. Contrairement à Del Piero, Baggio connaissait le rôle de meneur de jeu de la Squadra par cœur, car il y avait excellé par le passé. Il ne tarda pas à se mettre en évidence, et fut décisif dès la dixième minute, lorsqu’il réceptionna une longue transversale de Maldini, remise instantanément, sans contrôle, d’un plat du pied qui n’avait rien perdu de sa précision, pour un Vieri buteur. 1-0 pour l’Italie. Un doublé de Salas fit craindre à l’Italie un départ difficile, du même acabit que l’entame américaine, mais à la 85ème minute, après avoir offert une balle de but manquée par Inzaghi, Baggio intercepta un ballon sur le côté droit de la surface de réparation, et trouva la main d’un joueur chilien, obtenant de ce fait un pénalty. Quatre ans après, les fantômes de Pasadena planèrent quelques instants sur Bordeaux, mais le meilleur italien de la partie prit ses responsabilités, et transforma calmement ce pénalty en égalisation, dans le coin gauche – encore – de Tapia. Contrat plus que rempli pour un joueur que beaucoup d’observateurs étrangers croyaient finis. Quelques jours plus tard, à Montpellier, l’Italie devait rencontrer le Cameroun, avec Baggio une nouvelle fois titulaire. Et dès la septième minute, il centra sur la tête de Di Biagio pour l’ouverture du score. Décisif, comme d’habitude. A la 65ème minute il fut remplacé par un Del Piero guéri, qui allait devoir justifier son statut officiel de titulaire. 3-0 à la fin du match, avec un Baggio efficace et déterminant. Le dilemme attendu était devenu réalité. Baggio ou Del Piero ? Le premier, après deux grandes parties, était en position de force, mais Maldini résista aux pressions, et maintint son raisonnement d’origine : Del Piero était remis de sa blessure, et serait aligné d’entrée contre l’Autriche. Baggio irait sagement s’asseoir sur le banc. A la 48ème minute Del Piero frappa un coup franc décalé sur la gauche, repris de la tête par Vieri. 1-0 pour l’Italie. Del Piero venait de fournir sa seule contribution statistique et numérique de la compétition. Il fut remplacé à la 73ème minute par un Baggio encore et toujours efficace, avec une balle de but vendangée par Inzaghi, et un but bien réussi par le premier sur passe du second, à la 89ème minute. Bilan chiffré du premier tour : deux buts et deux passes décisives pour Baggio, contre une passe sur coup de pied arrêté pour Del Piero. Les supporters italiens ne s’étaient pas trompés, mais leurs protestations derrière le banc de Maldini lors du huitième de finale contre la Norvège furent vaines : l’homme du premier tour n’entra pas en jeu.
Remplaçant contre la France, Baggio, comme ses supporters, a longtemps dû croire sa compétition terminée. Moi aussi, pour être honnête. Quelques jours après la dernière épreuve du baccalauréat, je me réjouissais de pouvoir profiter pleinement de la compétition, et d’assister à la renaissance de celui que je considérais invariablement comme le meilleur joueur du monde. Je fulminais contre un entraîneur borné, aveugle, et incompétent. Ce dernier, qui avait donné deux Coupes d’Europe des Clubs Champions à mon club de cœur bien avant ma naissance était en train de me taper sur les nerfs, à moi comme au peuple italien dans son ensemble. La télévision française n’avait pas manqué de repasser en boucle au journal télévisé les images des supporters excédés derrière le banc des remplaçants au tour précédent. L’Italie pouvait-elle battre la France en jouant à dix ? Tout le monde connaît aujourd’hui la réponse. Face à des joueurs élevés à la sauce calcio, il a manqué à la Squadra l’étincelle offensive indispensable à ce niveau. Quand Baggio est entré, à la 67ème minute, à la place de l’imposteur qui occupait son poste, il était trop tard. On a bien cru au miracle lorsqu’il a failli tromper Barthez dans un angle impossible d’une magnifique volée, mais la France tenait son match, et l’Italie était exténuée. Je me demande encore aujourd’hui comment Cesare Maldini a pu négliger à ce point son atout maître. Baggio est de ceux qui font la différence, et je demeure convaincu que s’il avait démarré ce quart de finale, l’issue eût pu être différente. Ce qu’il ne savait pas, c’est que ces quelques minutes de jeu contre la France étaient ses dernières avec le maillot azur sur les épaules en match officiel. Zoff et Trapattoni lui ont, eux aussi, préféré un peintre fantomatique, en 2000, 2002 et 2004. Qui a dit que les sélectionneurs italiens étaient masos ?
Entre 1998 et 2000, Roberto a connu des fortunes diverses à l’Inter. Moratti l’a pris pour un nouveau jouet, à associer à Ronaldo, sans projet sportif réel. Ces deux ans ont été ponctués d’exploits, de blessures, et de mal-être. L’Inter, spécialiste en anéantissement de carrières, n’était clairement pas un club pour Baggio. Signalons tout de mêmes ses exploits en Ligue des Champions, contre le Real par exemple, en marquant un doublé décisif après être entré en jeu, ou encore ses buts magnifiques en championnat, contre la Roma en 1999 notamment. Le 23 mai 2000, en cadeau d’adieu à Lippi - dont il sauva ainsi la tête, pas rancunier - et aux tifosi, il a offert la qualification en Ligue des Champions lors du match de barrage contre Parme : en ouvrant le score d’un magistral coup franc, puis en redonnant l’avantage à son équipe d’une somptueuse volée du gauche. La classe, tout simplement, à deux semaines du début de l’Euro 2000, où Del Piero vendangea … encore.
Je me suis posé beaucoup de questions en apprenant que son nouveau club s’appelait Brescia. Le lien avec l'aventure bolognaise était évident : le joueur aspirait à retrouver un environnement plus calme, afin de se préparer pour la Coupe du Monde 2002. En France, les observateurs lui prédisaient une fin de carrière misérable, dans un club médiocre, sans objectifs réels, sans cet aspect clinquant et lucratif propre aux clubs à rayures, et si plaisant pour les journalistes. Mais c’est bel et bien à Brescia que le joueur italien le plus adulé dans son pays – élu quatrième meilleur joueur de l’histoire du football derrière Maradona, Pelé et Eusebio lors du grand sondage internet de la FIFA en 2000 – marqua 45 buts en 98 matchs, tous plus beaux les uns que les autres, en étant chaque année l’un des mieux notés aux pagelle de la Gazzetta Dello Sport. Ses performances étaient telles que, jusqu’à sa retraite en mai 2004, les pressions pour son retour en sélection ont perduré. Le Trap, malin, lui accorda une sélection d’honneur en amical contre l’Espagne lors de sa dernière saison, mais l’expérience fut bien amère pour un public pleinement conscient de tout ce que le joueur était capable d’apporter à une sélection en mal de meneurs. Jusqu’à la fin, Roberto tint son équipe à bout de bras, et fut un danger constant pour les meilleures défenses du championnat, en faisant simplement parler sa classe, son élégance, son pied droit magique, et ses inspirations géniales.
Roberto Baggio fait partie du club très fermé des joueurs ayant marqué plus de 300 buts dans leur carrière. Aujourd’hui considéré par une grande majorité de transalpins comme le meilleur joueur italien de tous les temps, il conserve une côte de popularité inégalée, malgré ses rares apparitions publiques. Discret, peu disert, il restera à jamais l’un des plus grands symboles du sport italien, et l’une des plus belles images du sport en général. Plus que l’homme d’une ville ou d’un club, Baggio restera l’homme d’un pays. J’ai pour ma part aimé le foot avec Baggio, et je n’oublierai jamais le don si rare qu’il avait pour captiver un public, suspendu à ses pieds fragiles et magiques à la fois. Avec Baggio le temps s’arrêtait, maintenant il fuit …
Andrea Pirlo, il maestro

« Le danger c’est Pirlo », avait déclaré Domenech à ses joueurs lors de la préparation du match France-Italie Espoirs en 1999. Déjà stratège de sa sélection nationale, le jeune milieu offensif intériste était une source d’inquiétude majeure pour tout opposant. Inquiétudes fondées, et confirmées, car l’Italie élimina la France d’Henry et Trezeguet, grâce à un coup franc magistral décisif de son numéro 10. Sept ans plus tard, Pirlo fut déclaré homme du match de la finale de la coupe du monde, remportée aux tirs au but par l’Italie, contre la France de Domenech. Qui a dit que l’histoire ne se répétait jamais ?
L’Inter, éprise depuis peu des Santon et Balotelli, sans doute par anticipation d’un possible décret 6+5, ne s’est jamais occupée de ses jeunes après l’arrêt Bosman, et le peu de temps de jeu accordé par Simoni, Lucescu ou Lippi à Andrea au début des années 2000 était de toute évidence peu propice à l’épanouissement du jeune prodige, qui ne cessait de briller avec les Espoirs. Mais l’Inter a involontairement servi la carrière d’Andrea à deux reprises : tout d’abord en le prêtant à Brescia, sa ville natale, lors de la saison 2000/01, lui permettant ainsi d’évoluer aux côtés du maître Roberto Baggio, et d’y développer en particulier les qualités de vision du jeu et de précision, devenues aujourd’hui ses marques de fabrique. Puis, en le cédant à Milan pour une bouchée de pain, cette même année.
Barré par des stars confirmées comme Rui Costa et Rivaldo, le jeune Pirlo ne put s’imposer dès son arrivée, et il fallut un repositionnement tactique made in Ancelotti pour lui assurer une place permanente dans le 11 type d’un des plus grands clubs du monde, poussant même Redondo et Albertini vers la sortie, s’il vous plait. Déterminant lors de la victoire en Ligue des Champions en 2003 et lors du titre de champion d’Italie en 2004, le virtuose Pirlo ne tarda pas à se faire un nom parmi les artistes les plus doués de sa génération. Diaboliquement précis, docteur ès organisation, il devint rapidement la tête pensante et le métronome du Milan AC. Orfèvre de la passe à l’art consommé du dribble, il incarne depuis lors ce qu’on pourrait qualifier d’élégance utile. Pirlo n’entre pas sur le terrain pour lui, mais pour l’équipe ; il n’arpente pas les pelouses européennes pour faire le spectacle mais pour faire vivre ses partenaires ; il ne dribble pas pour dribbler, mais pour conserver le ballon ou créer un danger soudain et mieux servir ses attaquants par la suite. Pirlo est l’antithèse du footballeur star ou tendance. Sa discrétion hors du terrain en témoigne.
Pirlo est un créateur au premier sens du terme. Il invente, dessine, peint, brise les codes d’un sport devenu monotone, passe outre les contraintes spatiotemporelles, défie les lois naturelles, voit avant tout le monde, partenaires et adversaires. Peu rapide mais vif d’esprit et de jambes, il est passé maître dans l’art de la syncope, du toucher de balle à contretemps, ce qui lui permet de jouer ses gammes sur des portées indéchiffrables par l’ennemi, et de clore en cadence parfaite une mélodie qu’il est seul à maîtriser. Jamais à court d’inspiration, Pirlo alterne dribbles, passes, jeu court, jeu long, frappes et centres, avec la même aisance. Aussi doué pour les transversales millimétrées que pour les passes courtes ou à terre dans des angles et des environnements difficiles, sa technique individuelle est prolifique en toute circonstance, peu importe le nombre d’opposants dans son périmètre.
Toutefois, il arrive que les expériences audacieuses et novatrices soient de courte durée. Meneur de jeu de formation, Pirlo a conquis ses galons de titulaire dans un club prestigieux à un poste qui ne lui a que très temporairement convenu, et qui a fini par lui nuire, l’user. La saison 2005-2006 illustre parfaitement le propos. Dans une équipe aux latéraux de plus en plus offensifs et au Seedorf de moins en moins affuté physiquement, le bridage et les contraintes tactiques imposés à Pirlo ont sérieusement entamé son aura et sa forme physique. Réduit à passer le plus clair de son temps à défendre, jouer contre nature, s’épuiser à des tâches qui ne correspondent en rien à ses attributs, le numéro 21 milanais a perdu pied. L’effet de surprise de 2003 ne fonctionnait plus, et les équipes adverses ont su façonner des systèmes anti-Pirlo, qui n’ont fait qu’enfermer le joueur dans un épuisement physique et moral sans précédent. A force de s’entêter dans une configuration dépassée et une idée dont l’originalité de départ avait été sérieusement éméchée par le temps, Ancelotti a fini par affaiblir un joueur, qui avait été une force les années précédentes. Cependant, un autre entraîneur avait une conception plus ambitieuse du rôle à donner à Pirlo. En cette année de coupe du monde, Marcello Lippi comptait bel et bien faire figurer le joueur en bonne place dans son onze de départ, en lui confiant les clefs du jeu azzurro pendant la compétition. Incapables d’intégrer les considérations tactiques dans leurs raisonnements, de nombreux supporters réclamaient la tête de Pirlo, mais Lippi n’en eut cure.
C’est en titulaire que Pirlo démarra cette coupe du monde face au Ghana. Face aux Muntari, Essien et Appiah, le génie milanais devait, allait s’écrouler, c’était une certitude. Que nenni ! Buteur et passeur décisif, Pirlo fut déclaré homme du match, avant de renouveler l’expérience en demi-finale contre l’Allemagne, et en finale contre la France. Triple passeur décisif, il put exprimer pour la première fois de la saison l’étendue du talent, dans un rôle à la fois proche et éloigné de l’originel. Positionné devant la défense sur la feuille de match, il put jouir d’une liberté totale de création et de déplacement, en électron libre à la Baggio, en se retrouvant par exemple à maintes reprises aux abords de la surface de réparation adverse. L’extinction progressive de Totti ne fit qu’accroître cette mainmise sur le jeu des triples champions du monde, et Andrea emmena match après match les siens vers la quatrième étoile. La présence d’une vraie défense, d’un milieu récupérateur pur, et d’autres milieux sacrifiés (Perrotta, Camoranesi), ainsi que les consignes d’un coach lucide, facilitèrent l’explosion pure et simple du talent et de la classe de Pirlo aux yeux du monde entier. Consacré joueur d’exception, le palier ultime était enfin franchi ; mais, l'homme était toujours aussi discret, ce qui lui valut d’être « oublié » par les électeurs du ballon d’or 6 mois plus tard.
Le retour sur terre à San Siro en septembre 2006 fut délicat, car Ancelotti n’avait visiblement pas pris conscience des raisons de la baisse de régime de son protégé quelques mois auparavant. Il lui fallut 6 mois supplémentaires pour admettre la nécessité d’inclure un deuxième vrai récupérateur dans l’entrejeu, afin de libérer et débrider son créateur. Les résultats furent spectaculaires : transfiguré, Pirlo retrouva des couleurs, et fut déterminant aux côtés de Gattuso et Ambrosini dans la conquête de la Ligue des Champions 2007. A son vrai niveau, libre de toute contrainte, il assuma à la perfection ses fonctions de prédilection : créer, mener, organiser.
En cette saison 2009/2010, Andrea a connu la première grosse blessure de sa carrière, blessure très mal gérée par le staff milanais. En effet, après deux mois et demi sans jouer, il fut réintégré, dès son retour, dans l’équipe de départ, en novembre dernier, pour mieux rechuter une semaine plus tard. En outre, les nombreuses blessures de cadres comme Gattuso ont contraint Ancelotti à modifier son système tactique, et à enlever un récupérateur. Les performances d’Andrea, après le mois de janvier, sont très irrégulières. Bonnes avec deux récupérateurs, comme contre Cagliari, et variables avec un seul récupérateur, selon le niveau de l’adversaire. Lippi, quant à lui, poursuit le processus salvateur de retour aux sources, en redonnant à son stratège le poste de ses débuts. Contre le Montenegro et l’Irlande, Andrea a joué derrière les deux attaquants, en position de numéro 10. Il fut à l’origine des trois buts de son équipe …



